Dès 1967, on avait pu lire ses premiers textes. Il devint l’une des grandes figures des Cahiers du Chemin. Un poète qui savait le Grec, le Latin, la belle langue française. Il les enseignait. Cet homme secret et bon s’est éteint le 11 novembre. Il avait eu 90 ans en juillet. Un très grand écrivain.
Il était farouche, peu à l’aise avec le monde tel qu’il vous cerne, dès que vous êtes repéré comme un écrivain qui compte. Mais il n’aurait pas pu ne pas publier, et, les deux prix importants qui ont marqué son parcours, le prix Max Jacob en 1985, le grand prix de poésie de la Ville de Paris en 2000, sans oublier cette semaine, à sa poésie consacrée, en 2012 (avec parution d’un ouvrage, deux ans après), sont là pour dire que pour en retrait s’était-il tenu, il avait ses lecteurs. Il avait sa place.
Jacques Dufour, né le 1er juillet 1930, s’est éteint le 11 novembre, près de Lisieux, non loin d’Orbec où il aura passé sa vie. Il enseignait à Bernay. Il s’était forgé ce beau nom, mystérieux, étrange, de Jude Stéfan en tressant son amour de Jude l’Obscur de Thomas Hardy et Joyce bien sûr et le vieux mot de l’anglais archaïque, Steorfan. La mort. En retira-t-il l’or, comme il disait, et c’était son nom.
Il a beaucoup écrit. Il a été publié. Lu. Lorsque les premières éditions du Printemps des poètes avaient eu lieu, on l’avait invité à s’exprimer dans les colonnes du grand journal où l’on travaillait alors. Il ne dépassait pas la Gare Saint-Lazare. Il arrivait d’Orbec, célèbre pour avoir accueilli la reine Elizabeth, en visite dans les grands haras normands, l’année même où Jude Stéfan avait publié son premier recueil. Cyprès date de 1967. Comme le déjeuner de la reine au Caneton, grande adresse disparue…
Il en souriait autrefois. Il savait rire. Il n’était pas morose ou rugueux. Il ne trouvait pas beaucoup de raisons d’espérer dans notre monde, mais il aimait le ciel, la nature, les lumières, les animaux, l’amour, les femmes, les Grecs, les Latins. Il aimait. Il partageait.

Il écrivait. Et ces textes, poèmes, nouvelles, formes très brèves, tout envoûte, enchante, emporte, bouleverse. Tout impressionne, bouleverse, tout émeut et trouble.
On ne fera pas ici une analyse de cette écriture unique, de cette voix si personnelle, qui ne ressemble à celle de personne mais qui est gorgée des sucs de la plus haute littérature, des savoirs les plus profonds, les plus anciens.
Et les blessures. Les drames fondateurs. Si Jude Stéfan a sa place dans ces colonnes consacrées plus particulièrement à l’art dramatique, c’est que les grandes figures, des plus archaïques aux plus proches en passant par Shakespeare, surgissent ici et là.
Il faut le lire. Lisez-le Libères, 1970 ; Idylles suivi de Cippes, 1973 ; Aux Chiens du soir, 1979 ; Suites slaves, 1983 ; Laures, 1984 ; À la vieille Parque, 1989 ; Prosopopées, 1995 ; Epodes ou poèmes de la désuétude, 1999 ; La Muse Province, 2002 ; Que ne suis-je Catulle, 2010 ; Disparates, 2012.
Ou ses nouvelles, impressionnantes : Vie de mon frère, 1973, La Crevaison,1976, Lettres tombales, 83, Les Etats du corps, 87, jusqu’aux années 2000.
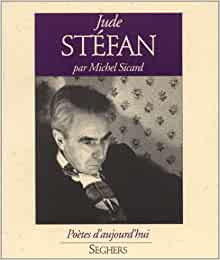
On ne saurait tout citer. Jude Stéfan n’a cessé de travailler. Des essais très éclairants, des pages de circonstance, savoureuses, profondes. Il n’a jamais cessé de passer au tamis d’une écriture superbe, sa vie, ses pensées, ses impressions. Il a sublimé cette vie, tout en demeurant au plus près du parti pris de la réalité. Il faut le lire.
On peut lire le livre très sensible de Michel Sicard, Jude Stéfan, dans la collection Poètes d’Aujourd’hui, chez Seghers.
